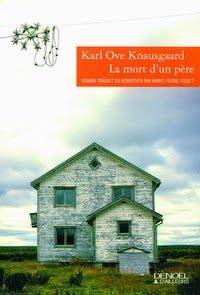L’auteur et son projet :
Après avoir connu le succès avec ses deux premiers romans (
non édités en français), Karl Ove Knausgaard, auteur norvégien, entreprend
l’écriture d’un cycle autobiographique en 6 tomes. Le cycle paraît en Norvège
et en Suède dans son intégralité de 2009 à 2011 sous le titre étonnant et très
controversé : Mon Combat. Controversé au point que son éditeur
allemand refusera de le publier sous ce titre. Malgré ça, le succès est
immédiat, les compliments, les prix aussi bien que les critiques fusent. Parmi
ces dernières, ce sont surtout celles de la famille qui ont le plus d’écho.
Voilà Karl Ove qualifié de Judas. Avec la même mésaventure qu’a connu Edouard
Louis au sujet de son livre, on est en droit de se demander si l’écriture
autorise tout et si la littérature est un art qui se doit d’exclure la sphère
privée.
Autre polémique : le titre. Pourquoi donc Mon Combat
et cette référence à Hitler ? Lorsque le magazine New-Yorker lui demande
d’expliquer le choix de son titre, Karl Ove reste évasif et si le lecteur
espère obtenir la réponse après lecture des 6 tomes, il en sera de sa
déception.
Après plusieurs idées de titre, c’est au cours d’une
conversation avec son meilleur ami Geir ( qu’on retrouve dans le livre) que
« Mon Combat » surgit. Malgré quelques hésitations, Geir lui affirme
qu’il a trouvé son titre. Karl Ove ne désapprouve pas. Provocation délibérée
pour susciter la curiosité et l’intérêt ? L’auteur s’en défend en
prétendant qu’il n’espérait même pas avoir de succès commercial. Au contraire,
pour lui, ce titre était une façon de repousser le lecteur, de ne pas en faire
une accroche esthétique conçue pour plaire. Au moins, avec un titre comme
celui-ci, le lecteur ne saurait à quoi s’attendre.
Et pour cause, nulle trace d’antisémitisme ni même de vues
politiques quelconques dans cette œuvre qui pourrait relever d’une éventuelle
ressemblance avec l’ouvrage du dictateur nazi.
Le 6ème et dernier tome inclut pourtant un essai
consacré à Mein Kampf et aux premières années d’Hitler que Karl Ove n’a
décidé d’écrire qu’une fois déterminé le titre de son cycle.
Il y tente d’humaniser Hitler et jette le doute sur l’idée
que le chef nazi avait déjà très tôt le mal en lui. Selon lui, le danger est de
croire qu’Hitler était une exception et que jamais personne ne pourrait
l’égaler.
Malgré cette curiosité, l’œuvre de Karl Ove est purement
autobiographique. Sa genèse est due à un événement marquant pour
l’auteur : la perte de son père. Ecrire et en parler était devenu une
nécessité. Ce sera d’ailleurs le thème du premier tome.
Un homme amoureux, le tome 2 de Mon Combat, mon avis :
Je vous laisse deviner quel mot m’a échappé des lèvres
lorsque, en tournant la première page d’Un homme amoureux, je me suis
aperçue qu’il s’agissait d’un tome 2 … Mais heureusement, il se lit très bien
sans le tome 1.
Alors que le premier volet était donc consacré à la mort du
père de Karl Ove et à son deuil, le deuxième tome, lui, s’attache à ses amours,
sa vie de famille et son travail d’écrivain.
Le récit offre le regard d’un homme qui se sent prisonnier
d’un quotidien qui l’étouffe, d’un homme tiraillé entre son souci de bien
faire, de respecter les exigences sociales bien qu’il ait le conformisme en
horreur et son envie d’écrire. L’écriture est, pour lui, au même titre que
boire, manger et respirer, un besoin vital, un besoin que les obligations de la
vie quotidienne viennent contrecarrer. Une vie quotidienne subie plus que vécue
d’où ne ressortent que l’ennui, la frustration et l’insatisfaction :
« La vie quotidienne, avec son lot de devoirs et d’habitudes, je l’endurais. Mais elle ne me réjouissais pas, je n’y voyais aucun intérêt et elle ne me rendait pas heureux. Ce n’était pas le manque d’envie de laver par terre ou de changer les couches mais quelque chose de plus profond que j’avais toujours ressenti : l’impossibilité d’y voir une quelconque valeur doublée d’une profonde aspiration à autre chose. Si bien que la vie que je menais n’était pas la mienne. J’essayais de la faire mienne, c’était mon combat, je le voulais vraiment, mais en vain, car mon envie d’autre chose vidait tout ce que je faisais de son contenu. »
De longs passages sont consacrés à son introspection, à la
recherche des raisons qui pourraient expliquer son incapacité à trouver
l’épanouissement . Il explore plusieurs pistes : nostalgie d’un temps
révolu, responsabilité d’une époque dont les valeurs se perdent. C’est
l’occasion de quelques mots loin des propos consensuels qu’on entend partout
sur le sentiment d’émasculation des hommes dans une société de plus en plus
féminisée :
« Je n’ai pas été assez prévoyant et j’ai dû suivre les règles du jeu en vigueur. Et dans le milieu socio-culturel auquel nous appartenions, ça signifiait qu’on assumait tous les deux le même rôle, celui autrefois attribué aux femmes. J’étais lié à lui comme Ulysse à son mât : je pouvais certes m’en délivrer mais pas sans perdre tout ce que j’avais. Et je déambulais, moderne et féminisé, dans les rues de Stockholm, alors qu’en moi bouillait l’homme du dix-neuvième siècle. »
Auteur emblématique du nihilisme, ce n’est pas pour rien si,
au cours du récit, on retrouve Karl Ove en pleine lecture de Dostoïevski ou si
le nom de l’auteur revient à plusieurs reprises.
Dans une existence qui lui semble vide de sens et dans
laquelle toute relation sociale semble forcée et artificielle, Karl Ove voit le
conformisme comme seul moyen de faire vivre ensemble des personnes qui n’y
aspirent pas par nature.
« Et pourquoi crois-tu que la normalité soit si enviable, si ce n’est pour cette raison ? C’est le seul terrain sur lequel on est sûr de pouvoir se rencontrer. Mais même là, on ne se rencontre pas forcément. »
De là, sa tendance à se plier aux normes sociales tout en
les rejetant et les critiquant et tout en cherchant désespérément un bonheur
qu’il croit interdit ou impossible à atteindre. Karl Ove est un homme à fleur
de peau en manque d’estime de soi et qui cherche à se rassurer au point qu’il
en devient contradictoire entre ce qu’il pense et ce qu’il fait. Il est par
exemple très soucieux de l’image qu’il renvoie dans les médias tout en essayant
de s’en distancier et de ne pas y accorder d’importance. Ses relations avec les
journalistes et sa façon de gérer ses obligations d’écrivain sont révélatrices
de cet état.
 |
| " It immerses you totally. You live his life with him. . . . " Zadie Smith, The New York Review of Books |
Karl Ove va très loin dans l’introspection et la réflexion.
Son souci de la justesse et de la précision s’exprime jusque dans les moindres
détails, le moindre geste même le plus banal comme se servir un café, le
moindre regard, la moindre pensée sont retranscrits. Certains pourront trouver
le tout lourd et ennuyeux. Moi j’ai trouvé ça incroyable. Etre complètement
immergée dans la vie de Karl Ove, l’accompagner de si près. Bien que je n’ai
pas toujours été d’accord avec certaines de ses idées que j’ai jugées trop
rétrogrades, je me suis sentie très proche de cet homme touchant dans son
honnêteté. Pour un homme qui semble avoir autant de mal à se confier, il aura
trouvé dans l’écriture de ce cycle un moyen de se livrer complètement, à nu,
au regard des autres. C’est troublant au point qu’une fois le livre achevé, on
a l’impression de se séparer d’un ami de longue date.
Certains événements de la vie de Karl Ove l’ont beaucoup
marqué, il en ressort des scènes « coup de poing » exprimant de
manière poignante la souffrance lorsque Linda le rejette la première fois, ou
encore l’impuissance lorsqu’elle accouche ( passage magnifique) où l’on ressent
bien le besoin de l’auteur de créer un effet libérateur et cathartique. Sa
façon de parler de sa relation avec Linda, le passage d’un état passionnel
destructeur au mépris le plus profond est brillamment décrit.
Le style est celui d’un écrivain qui ne cherche pas à faire
beau. Il ne veut rien d’artificiel. Karl Ove écrit sans fioriture, pour lui la
littérature se sublime dans la liberté de ton, dans l’écriture spontanée et
s’inscrit surtout dans la réalité. Karl Ove ne veut rien inventer :
« Je ne pouvais pas écrire de cette façon, ce n’était pas possible, à chaque phrase je me disais : tu ne fais qu’inventer. Ça n’a aucune valeur. Ce qui est inventé n’a aucune valeur[…] La seule forme qui eût encore de la valeur à mes yeux, qui eût du sens, c’était les journaux personnels et les essais, autrement dit ce qui dans la littérature ne produisait pas des histoires, ne racontait rien et se contentait d’être une voix, la voix de la personnalité propre, une vie, un visage, un regard que l’on peut croiser. Qu’est-ce qu’une œuvre d’art sinon le regard d’un autre être humain ? […]
Arrivé là, j’étais au pied du mur. Si la fiction était sans valeur alors le monde l’était aussi car c’était au travers de la fiction qu’on le voyait aujourd’hui. »
Ce qui ne l’empêche pas de construire son récit de manière
cyclique baladant son lecteur dans son passé et ses souvenirs. Mais le texte
est fait d’un seul bloc, sans chapitres, dans un seul souffle. Ce texte, c’est
la vie dans toute sa complexité, des sentiments qu’on ne contrôle et ne
s’explique pas, des événements subis, des réflexions, interrogations
existentielles.
J’aurais encore tant à dire tellement ce livre est dense,
profond, intense. Je ne crois pas exagérer en affirmant qu’il doit être un des
plus beaux écrits qui existent sur notre époque. Je lirai assurément le tome 1
et les autres qui, j’espère, ne tarderont pas trop à être publiés.
Un très grand merci à Dana et aux éditions Denoël pour cette
merveilleuse découverte.
Un homme amoureux - Karl Ove Knausgaard
Traduction: Marie-Pierre Fiquet
Editions Denoël
784 pages
26,90 euros
Parution : 04 sept. 2014