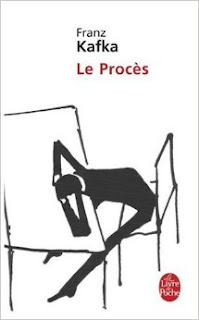« Puisqu’il nous faut absolument des livres, il en existe
un qui fournit, à mon gré, le plus heureux traité d’éducation naturelle. Ce
livre sera le premier que lira mon Émile ; seul il composera durant longtemps
toute sa bibliothèque, et il y tiendra toujours une place distinguée. Il sera
le texte auquel tous nos entretiens sur les sciences naturelles ne serviront
que de commentaire, il servira d’épreuve durant nos progrès à l’état de notre
jugement ; et, tant que notre pur ne sera pas gâté, sa lecture nous plaira
toujours. Quel est donc ce merveilleux livre ? Est-ce Aristote ? Est-ce Pline ?
Est-ce Buffon ? Non ; c’est Robinson
Crusoé. »
Rousseau - Emile ou de l'éducation
Dès notre plus tendre enfance, notre imaginaire est nourri
de contes, légendes et histoires dont on a parfois du mal à connaître l’origine
mais qui finissent par nous être si familières qu’on se retrouve tout étonné,
lorsque parvenus à l’âge adulte, nous redécouvrons ces personnages et aventures
fabuleuses et que nous nous apercevons à quel point ces petites histoires que
l’on croyait enfantines sont riches en enseignement et bien plus complexes
qu’elles ne le laissent paraître.
Robinson Crusoé fait partie de ces mythes littéraires qui
font la richesse de notre patrimoine culturel mondial. Précurseur d’un genre ,
la vie de cet aventurier fictif créé par Daniel De Foe a inspiré par la suite
nombre d’autres récits, films et œuvres en tout genre que l’on a coutume de désigner
sous le nom explicite de « Robinsonnades ». Les exemples sont légion
mais parmi les plus célèbres on peut citer Le
Robinson Suisse de Johann David Wyss, Sa
Majesté des Mouches de William Golding, L’Île
mystérieuse de Jules Verne et la célèbre réécriture Vendredi ou les limbes du Pacifique par Michel Tournier.
Je me souviens qu’en classe de 5ème, ma
professeur de français avait choisi de nous faire étudier la version pour
enfants du roman de Michel Tournier : Vendredi
ou la vie sauvage. Et je me rappelle à quel point j’avais été déçue de ce
choix car « je connais déjà l’histoire euh ! Moi je veux lire Fantômette !». Plus de vingt ans
après et sur les conseils insistants de mon mari, j’ai voulu revenir à la
source et redécouvrir les aventures de Robinson Crusoé par Daniel De Foe.
Je sais qu’il existe une traduction toute récente du roman,
néanmoins j’ai lu celle qui faisait foi depuis le XIXème siècle c’est-à-dire la
traduction de Petrus Borel que j’ai beaucoup appréciée malgré quelques
tournures étonnantes ( apparemment le style de De Foe n’a pas été respecté) et
les quelques coquilles que comportait mon édition. A ce propos, j’ai lu une
édition poche GF-Flammarion vieille de vingt ans et pourtant le livre est comme
neuf, les pages sont toujours d’un blanc éclatant, je ne peux pas en dire
autant de mon édition du même âge d’Une
vieille maîtresse de Barbey d’Aurevilly chez Folio … ( les éditions
GF-Flammarion sont définitivement mes éditions poche préférées !)
Premier constat, je me suis rendue compte que j’ignorais
complètement ( ou avait complètement oublié ?) quelle avait été la vie de
Robinson avant le naufrage et son arrivée sur l’île c’est-à-dire de quel milieu
social il était, quelles étaient les raisons de son voyage en mer et quelles
étaient les circonstances du naufrage etc … Et j’ai donc découvert un jeune
homme de condition moyenne que son père souhaitait voir prendre le même chemin
que lui : celui d’une vie douce et tranquille, certes modeste mais à
l’abri des vicissitudes de la pauvreté et de l’ambition. Mais la jeunesse est
folle et veut voir le monde, Robinson fait peu de cas des désirs et des
avertissements d’un père au discours prophétique et fuit le foyer familial. Ses
premiers pas chaotiques sur les ponts des navires sont bien près de le faire
revenir à la raison et par là même à la maison. Mais la jeunesse est folle et
surtout entêtée. Robinson persiste dans sa voie maritime, traverse moultes
péripéties qui sont pour le personnage autant de mauvais présages et pour le
lecteur autant d’occasions d’appréhender la mentalité de l’époque ( nous sommes
au XVIIème siècle) que de s’en offusquer. Ne serait-ce qu’à travers les raisons
qui poussent Robinson à effectuer le voyage au cours duquel il fera naufrage.
Seul rescapé de la catastrophe, Robinson nage jusqu’à une île déserte et doit
alors organiser sa survie.
Deuxième constat, j’ai réalisé à quel point Robinson Crusoé
était un roman riche aux visions et interprétations multiples. Au-delà du
simple récit d’aventure propre à enthousiasmer et faire rêver les enfants, le
roman se pose en véritable éloge de la civilisation britannique et se fait le
chantre du colonialisme à travers une allégorie de l’empire britannique qui
transpire à travers différents détails.

La vision colonialiste transparaît principalement à travers
la relation Robinson/Vendredi qui est une relation de dominant à dominé.
Robinson ne traite pas Vendredi en égal mais bien en inférieur qu’il se doit d’amener
à la civilisation. Robinson va ainsi instruire Vendredi et lui inculquer son
mode de vie, sa culture, sa religion. Pas un seul instant il n’a la curiosité
de s’intéresser à la vie de Vendredi qui est natif de la contrée et doit donc
savoir bien mieux que Robinson comment exploiter les ressources de l’île et
vivre en harmonie avec elle. Le seul passage où il y a réellement échange c’est
au sujet de la religion, les questions de Vendredi sont d’ailleurs
croustillantes et mettent Robinson dans l’embarras. Mais en dehors de ce point,
le roman est une véritable vitrine des mentalités de son époque.
Seul sur son île, Robinson se l’approprie complètement, elle
devient sa possession personnelle, son domaine en lequel il est souverain tout
puissant. Vendredi est son sujet et de même sont ceux par qui viendra sa
délivrance. Ne se fait-il pas d’ailleurs nommé gouverneur ? Ne fait-il pas
de l’île sa colonie qu’il vient visiter une fois retourné dans le monde ?
Et c’est précisément ce qui a amené certains commentateurs à faire de Robinson Crusoé une allégorie de
l’empire britannique. Ainsi pour eux, la caverne que creuse Robinson afin d’y
mettre ses affaires en sûreté est un rappel de l’activité minière de la
Grande-Bretagne, activité à laquelle elle devra sa puissance ( argument un peu
anachronique non ?)
Robinson ne manque pas non plus de louer l’humanisme
britannique et la grandeur de la civilisation britannique en n’hésitant pas à
pointer du doigt l’autre grande puissance de l’époque : l’Espagne. Ainsi
Robinson s’offusque-t-il des massacres perpétrés sur les indiens d’Amérique par
la couronne espagnole ( mais par contre la traite négrière et l’esclavagisme ne
semblent pas lui poser de problèmes de conscience …).
J’ai été très surprise par les premières lignes qui
décrivent les premiers pas de Robinson sur l’île. Je m’attendais à des pleurs,
des lamentations et bien que De Foe nous fasse part un peu plus loin au cours
du récit des états d’âme de son survivant, j’ai trouvé, au lieu d’un personnage
désemparé et complètement perdu, un homme d’un flegme et d’un pragmatisme
étonnants. Immédiatement, Robinson réagit, tire de l’épave du navire tout ce
qui peut lui être utile, cherche un lieu où s’installer tout en étant à l’abri
d’éventuels sauvages ou animaux et tout en pouvant surveiller l’horizon.
Et pendant une grande partie du roman, Robinson décrit dans
les moindres détails tout ce qu’il entreprend. Bien qu’il ait pu récupérer pas
mal de choses sur le navire et notamment des armes et des vivres, il doit tout
de même voir plus loin et envisager le moment où ses réserves seront épuisées.
Ces pages peuvent peut-être ennuyer le lecteur par
l’abondance de détails qui lui paraîtront peu intéressants. Pour ma part, ça
m’a passionnée ! Parti du foyer familial en affirmant qu’il ne savait rien
faire, Robinson doit tout apprendre, exercer tous les métiers. Il est
gestionnaire, compte tout, vivres, munitions, poudre, le temps … Il est bucheron,charpentier,
menuisier, mineur, agriculteur, chasseur, potier, tailleur, boulanger. Il y a
ce passage magnifique où il fait remarquer que dans notre société confortable
on ne s’imagine pas le travail qu’il y a derrière un simple morceau de pain. Et
cet autre passage où il doit s’y reprendre à maintes et maintes reprises pour
obtenir un simple pot en terre dans lequel conserver ses aliments ou les faire
cuire. Robinson pourrait nous apparaître comme un surhomme mais il n’en est
rien car il peine et commet des erreurs.
Robinson transporte ainsi la civilisation qu’il connaît sur
son île. Mieux, il recréé une civilisation débarrassée du vice de l’argent et
de l’ambition, il aimerait tant échanger toutes ces pièces d’or contre de
simples ustensiles de cuisine ou une simple paire de chaussures. Ceci dit, tout
en maugréant sur l’inutilité de l’argent sur l’île, Robinson n’en récupère et
conserve pas moins tout celui qu’il trouve ! « Money It's a gas Grab
that cash with both hands and make a stash »
Eloge de la civilisation et en particulier de la
civilisation britannique, Robinson Crusoé
est aussi un roman moral d’apprentissage aux nombreuses références religieuses
et philosophiques.
Le roman prend à de nombreuses reprises modèle sur la Bible.
La vie de Robinson se calque tour à tour sur celles de différents prophètes. D’une
façon générale il est Job, celui qui pouvait tout avoir et mener une vie
tranquille jusqu’à ce que Dieu en décide autrement, lui fasse tout perdre pour
lui rendre au centuple à la fin. Dans la première partie du roman, il est
Jonas, celui qui semble porter malheur à tous les navires sur lesquels il pose
les pieds. Puis sur l’île, il est Adam. Dans les descriptions et la narration
de De Foe, les allusions au Paradis biblique et à la Genèse sont évidentes.
Robinson, c’est celui qui ignorait Dieu et qui, par ses
aventures, va progressivement « rentrer dans le droit chemin ». Robinson Crusoé, c’est aussi le récit d’une
repentance, d’une expiation. La faute commise est de n’avoir pas écouté les
avertissements et conseils du père, d’avoir voulu braver le destin. La
révélation se fait lors d’un rêve, dès lors, Robinson se réfugie dans la
religion, étudie la Bible, prie. De là, quelques belles lignes de morale chrétienne
nous invitent à tempérer nos ambitions, à apprendre à nous satisfaire de ce que
l’on possède déjà, de ne pas convoiter les richesses d’un plus aisé que nous, penser
que notre sort est bien plus enviable que celui de certains autres et que la
situation pourrait toujours être pire que ce qu’elle est.
Mais De Foe inclut également dans son texte quelques références
philosophiques. J’ai surtout remarqué celles tenant aux idées de John Locke sur
l’argent et la propriété : dans l’état de nature, l’homme ne
recherche que ce dont il a besoin, il ne lui sert à rien d’accumuler. La situation
de Robinson correspond justement à celle de l’homme dans l’état de nature :
il est seul, n’a aucune concurrence pour la nourriture, il lui est donc inutile
de faire des réserves de denrées amenées à se gâter et ne recueille donc que le
nécessaire.
J’ai cru comprendre que De Foe s’inspirait aussi d’idées sur
le travail et la vie en société, la solitude et l’isolement. Je ne peux
malheureusement pas vous en parler car je n’ai pas approfondi la question et
mes connaissances en philosophie sont limitées.
Sur la forme, Robinson Crusoé est écrit à la première
personne, c’est donc Robinson lui-même qui nous narre ses aventures. Cette
vision auto centrée participe elle aussi à mettre l’accent sur l’homme blanc,
civilisé. C’est Robinson le héros. Michel Tournier prendra le contrepied de
cette vision. Je vous en parlerai très bientôt car j’ai l’intention de le lire
pour faire la comparaison.
Ce qui m’ a surprise c’est que à un moment donné, alors que
la narration s’effectuait normalement jusque là, De Foe adopte la forme du
journal. Je n’ai rien contre sauf qu’il l’abandonne complètement quelques pages
plus loin. Je pense qu’il a voulu cantonner l’emploi du journal à toute cette
période où Robinson est seul et effectue des tâches quotidiennes répétitives. D’ailleurs
, j’ai trouvé que les répétitions se sentaient un peu trop. Mais dès que l’action
reprend véritablement lorsque Robinson découvre une empreinte de pas, la forme
du journal est interrompue et la narration reprise normalement. Autre défaut,
la fin est complètement bâclée, je n’ai pas compris, on dirait que De Foe a
cherché à se débarrasser au plus vite, c’est très étonnant.
Néanmoins, j’ai adoré cette lecture qui m’a encore fait
rêver malgré que l’histoire soit connue. On peut vraiment dire que j’ai
redécouvert le mythe de Robinson. C’est un roman qui, avec toute sa richesse
cachée, reste un grand roman d’aventure. J’ai hâte de lire la version de Michel
Tournier !