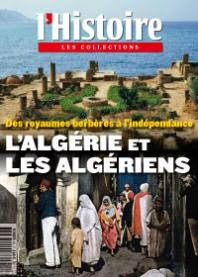La traversée est le récit d’un constat lucide et amer quant à la situation de l’Algérie au lendemain de l’indépendance. L’heure n’est plus à la fête des premiers jours mais au désenchantement, à la prise de conscience que tout est encore à faire, que l’obtention de l’indépendance n’était qu’une étape et non une fin.
A travers le personnage de Mourad et de son entourage, Mouloud Mammeri nous brosse le portrait d’une Algérie et d’algériens en pleine désillusion. Il emprunte pour cela plusieurs chemins à grand renfort de métaphores qui rendent son texte très poétique et lui confèrent une grande portée.
A défaut d’une analyse littéraire dont je serai bien incapable, je vous livre ici mon interprétation de cette œuvre majeure de la littérature algérienne.
Ecrit en 1982,
La traversée est le quatrième et dernier roman de Mouloud Mammeri. Il se situe donc dans un contexte post-colonial . A la sortie de l’ouvrage, ce dernier est immédiatement interdit par le pouvoir en place.
La censure, c’est ce que Mourad, journaliste à Alger-Révolution en pleine crise existentielle, n’accepte pas. Désavoué par ses collègues suite à la parution d’un article, Mourad souhaite démissionner et s’exiler en France. Pour lui donner le temps de la réflexion, son supérieur, Kamel, l’envoie en mission dans le désert saharien.
La traversée est un roman miroir dans lequel les dernières lignes répondent aux toutes premières et la traversée du désert de nos personnages reflète celle racontée par Mourad dans son article.
Cet article résume à lui tout seul le message délivré par l’auteur dans ce roman. Utilisant une métaphore, Mourad/Mammeri livre sa conception de l’Histoire récente de son pays. Le peuple algérien est alors assimilé à une caravane traversant péniblement le désert qui représente la période coloniale et la guerre d’indépendance. Cette caravane est menée par des « héros » à assimiler probablement aux grands noms du FLN. Ce groupe des héros s’amenuise au fur et à mesure de la progression de la caravane jusqu’à l’arrivée de celle-ci dans une oasis qu’elle croit être sa destination finale. Certains des héros survivants savent bien que l’oasis n’est qu’une étape mais ils sont peu à peu manipulés et convaincus de rester sur place par les épigones qui profitent de leur faiblesse pour s’accaparer tous les honneurs et prendre la direction des choses sans laisser place à d’éventuels concurrents ( le parti unique). Les caravaniers n’ont plus qu’à se soumettre au rôle qu’on leur laisse.
« Les caravaniers admirent de loin avec un soupçon d’ironie, car ils savent que les protagonistes passent mais que la caravane est éternelle. »
A l’image de la caravane, Mourad va lui aussi effectuer sa traversée du désert, accompagné de deux français, Amalia, chargée d’un reportage sur les compagnies pétrolières, Serge, le communiste, et de deux collègues algériens, Souad et Boualem, l’intégriste espérant retrouver dans le désert le souffle et la dimension des hommes du temps du prophète.
Chacun espère trouver ce qu’il cherche au cours de cette quête mais Mourad en reviendra aussi démuni qu’au départ et Boualem aura perdu ses illusions et sa confiance en Allah.
Le désert n’est plus ce qu’il était. Les sites pétroliers ont poussé comme des champignons et les ouvriers qui y travaillent ne se soucient que de leur pain quotidien. L’hôtel de Ghardaïa a perdu son faste d’autrefois et se délabre au fil du temps. De grandes villes ont émergé dans le sud à l’image des villes du Nord. L’administration post-coloniale cherche à éradiquer le mode de vie nomade et tente de convertir les Touaregs à la vie citadine.
Bref, le pays se transforme et c’est l’impression que la grandeur passée tombe en ruine qui règne. De même, lorsque Mourad retournera dans son village natal, c’est un village mort qu’il trouve, ruines et vieillards l’accueillent froidement, la jeunesse et la vie s’étant envolées vers des horizons plus prometteurs.
Ce même désenchantement s’incarne également dans le personnage de Ba Salem, habitant célèbre et respecté de Timimoun dont les seules joies consistent à s’occuper de son jardin et de ses tournesols ( symbole d’espoir ) et à écumer toutes les fêtes de la région. La perte de son épouse le plonge alors dans un état de prostration que les autochtones appellent l’amdouda : le renoncement.
Cette désillusion du peuple algérien se traduit jusque dans les relations amoureuses toutes vouées à l’échec : le couple franco-algérien formé par Christine et Kamel succombe sous le poids de la tradition, le couple formé par Ba Salem et sa seconde épouse miné d’avance par l’amdouda, et enfin les tentatives de Mourad et Amalia.
L’Algérie voulait sa liberté, la caravane a traversé le désert pour l’obtenir. Mourad aussi voulait s’affranchir des contraintes. La liberté est un thème cher à Mouloud Mammeri fervent défenseur de la culture berbère ( n’oublions pas que les berbères ont combattu les romains et les arabes ),un désir de liberté que l’on retrouve à travers Mourad mais aussi Ba Salem ( qui souhaitait ne faire que ce qui lui plaisait), et surtout à travers les nomades du désert.
Le passage de l’école à Djanet m’a particulièrement marquée. J’ai évoqué la volonté du pouvoir de mettre fin au nomadisme, pour cela il a utilisé l’école mais ça ne se passait pas toujours comme ils le voulaient. A la question « que veux-tu faire plus tard ? », les jeunes Touaregs répondent unanimement : « chauffeur » et lorsqu’on leur demande pourquoi : « parce qu’on va où on veut. » est la réponse. Tous ces élèves ont la liberté dans le sang au point de pleurer lorsque le maître, fort décontenancé par cette réaction, leur fait lire le célèbre poème d’Eluard : Liberté.
« Ce n’était pas précisément un cours sur Eluard, c’était un cours de grammaire. Je voulais seulement prendre un exemple. »
Bien sûr, le combat indépendantiste a aussi sa place dans le récit avec quelques passages narrant les activités de Mourad et Amalia au sein du FLN pendant la révolution. Le passage de l’assassinat des bonnes sœurs par les soldats français m’a particulièrement marquée ( à mon avis, cet événement n’est pas que fictif …). Mais d’autres mouvements de libération sont aussi évoqués comme ces deux québécois indépendantistes venus en Algérie chercher du travail ( gag …) « Dans un pays socialiste, il y a le droit au travail. Et puis on a regardé quand on est arrivé : du travail, beaucoup d’algériens n’en ont pas. » Et nos deux canadiens de ressentir l’effet de la désillusion eux aussi.
Car la liberté a un prix et peut être dangereuse. Nos personnages ne font-ils pas d’ailleurs l’expérience de la folie du désert où Amalia manque d’être blessée ? Cette démence passagère qui atteint tous ceux qui, étourdis par cette immense sensation de liberté, bravent les grands espaces.
Et puis une fois la liberté acquise, rien n’est fini. L’oasis de l’article de Mourad n’est qu’un leurre. Le pays n’a pas encore atteint son but.
Ce texte de Mouloud Mammeri est donc d’une très grande richesse. Rien de ce qu’il écrit n’est anodin. Il nous trace un portrait social objectif de l’Algérie dans la décennie qui suit son accession à l’indépendance, la difficulté des relations humaines, les stratégies d’administration et de contrôle des populations, le manque de travail et la faim, tout est évoqué et illustré.
Le tout est de plus servi par une plume magistrale qui fait de Mouloud Mammeri un très grand écrivain.
En revanche, j'ai déploré le manque de descriptions. Même si certains passages invitent à l'évasion, j'ai trouvé qu'ils étaient trop peu nombreux. J'aurais voulu de longues descriptions de paysages pour me faire voyager et rêver. Mais ça aurait été laisser trop de liberté au lecteur et peut-être aurait-il été lui aussi atteint de la folie du désert. Et puis, La traversée est un roman qui a pour ambition de dénoncer un état de fait et de réveiller son lecteur plus que de le faire rêver.
La fin m’a beaucoup touchée car pas très optimiste. J’ai l’impression que Mouloud Mammeri était conscient que l’avenir serait sombre. D’ailleurs, quand il évoque Boualem et ses compagnons intégristes, il est difficile de ne pas penser à la funèbre décennie noire qui sera la conséquence de tout ce qu’a dénoncé l’auteur dans ce texte puisque les intégristes ont profité du désarroi de la population pour obtenir le pouvoir.
Je suis donc très contente de cette lecture ( et relecture ) d’autant plus que ce roman est introuvable en France alors quelle ne fut pas ma joie de le voir sur les étals des librairies oranaises !
"Car le monde des adultes, c'est pas la sortie du dimanche, c'est un monde balisé, fiché, piégé aux carrefours, avec des gendarmes pour contrôler ; sans ça où irions-nous ? Vous croyiez comme ça que vous alliez tous les deux aller et venir sur la terre sans coordonnées, sans papiers, sans étiquette ni étoile jaune ? Comme des sauvages ! Mais le temps des sauvages est passé. Il dure l'espace d'une révolution. Après vient le temps des lois, du bakchich, des balises sur les routes, le temps des papiers d'identité et du brouet noir. Parce que le paradis, il y a ceux qui le cherchent et ceux qui y sont arrivés, et ce ne sont jamais les mêmes ... et les arrivés sont toujours des arrivistes."